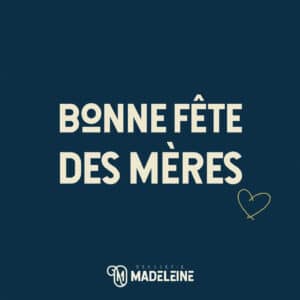Face à la cathédrale d’Orléans, un écrin de verre et de béton protège 65 000 œuvres sauvées tour à tour des saisies révolutionnaires, des bombardements de 1940 et des caprices du temps. Rubens, Vélasquez fraîchement réattribué, pastels de Chardin, installations contemporaines… le musée des Beaux-Arts mêle chefs-d’œuvre planétaires et histoires locales pour offrir, à moins d’une heure de Paris, une étape incontournable entre flânerie ligérienne et frissons de découverte.
Histoire du musée des Beaux Arts d’Orléans, révolution à aujourd’hui
Des confiscations révolutionnaires à l’ouverture en 1797, naissance d’une collection nationale
1793 : les saisies opérées dans les églises et chez les émigrés remplissent les greniers municipaux. Le marchand d’art orléanais Aignan-Thomas Desfriches s’associe au peintre Jean Bardin pour sauver ces œuvres de la dispersion. Leur plaidoyer trouve un écho à la Convention : les tableaux rejoignent d’abord l’ancien collège des Jésuites, puis, le 31 août 1797, ouvrent officiellement au public sous l’étiquette de « musée central du Loiret ».
Le jeune établissement reçoit aussitôt un flux régulier de dépôts de l’État. Écoles italienne, flamande, hollandaise, française, rien n’est exclu : l’esprit encyclopédique de l’époque veut montrer tout l’art à tous les citoyens. Cette abondance place Orléans parmi les premiers musées de province, aux côtés de Nantes ou Lille, et forge le socle d’un fonds qui atteindra deux siècles plus tard 65 000 pièces.
De la Seconde Guerre mondiale aux années 1980, résilience et architecture moderne de Christian Langlois
Mai 1940, les bombes frappent le cœur d’Orléans. Le musée perd le précieux fonds Fourché, parti en fumée. Les conservateurs organisent d’urgence l’évacuation des chefs-d’œuvre vers les caves de châteaux voisins. Après la Libération, les salles rouvrent progressivement, portées par les dons d’artistes locaux et la volonté municipale de remettre la culture au centre de la cité.
Les années 1970 font émerger une idée neuve : un bâtiment adapté aux normes de conservation. L’architecte orléanais Christian Langlois livre en 1984 un volume de verre et de béton face à la cathédrale. Cinq niveaux, 4 000 m² d’exposition, circulation fluide, lumière zénithale filtrée : l’édifice répond aux exigences climatiques des pastels et des grands formats. Le musée gagne un ascenseur panoramique, des réserves climatisées et un auditorium, ouvrant la voie aux grandes expositions d’aujourd’hui.
Collections permanentes, chefs d’œuvre du Val de Loire et art nord européen
Peintures flamandes et hollandaises des XVIe et XVIIe siècles, atout majeur pour les amateurs
Le premier étage déroule une fresque nord-européenne où l’œil passe d’un triptyque anversois à un paysage glacé de Brueghel le Jeune avant de plonger dans les grands formats de Rubens et Van Dyck. Ces toiles sont arrivées à Orléans après les confiscations révolutionnaires puis grâce à un patient travail d’échanges avec les musées de Gand et de La Haye. L’ensemble compte aujourd’hui plus de 150 œuvres, soit un des noyaux les plus fournis du pays, régulièrement rafraîchi par des prêts croisés qui alimentent la curiosité des connaisseurs comme des néophytes.
Le nouveau parcours inauguré en 2024 insiste sur les dialogues entre Nord et Val de Loire : natures mortes de fleurs qui rappellent le commerce fluvial, portraits bourgeois inspirés des marchands orléanais, sans oublier un rare panneau de Joachim Patinir acquis en 2022. Pour préparer la visite :
- La Chasse au lion de Rubens, spectaculaire pour ses diagonales audacieuses.
- Le Joueur de cornemuse de Frans Hals, fraîchement restauré, présenté à hauteur d’enfant.
- Un cabinet de gravures de Rembrandt accessible sur réservation en salle d’étude.

Pastels de Chardin et Quentin de La Tour, deuxième fonds de France et défis de conservation
Avec plus de 300 feuilles, le musée n’est devancé que par le Louvre pour la pastelomania française. Les visiteurs découvrent la délicatesse quasi photographique de Chardin, le velouté des carnations chez Quentin de La Tour ou encore les portraits mondains d’Étienne Liotard. Ce trésor fragile impose une rotation serrée : chaque pastel sort de réserve pour six mois maximum avant de regagner l’obscurité afin de préserver les pigments encore pulvérulents trois siècles plus tard.
Pour maintenir 50 lux et 20 °C constants, le musée a investi 120 000 € dans un éclairage LED dernière génération et dans un nouveau rideau d’air limitant l’humidité. Une fenêtre vitrée en galerie permet de suivre les restaurateurs à l’œuvre sans franchir la ligne sanitaire. Les médiateurs profitent de ces manipulations pour lever le voile sur les secrets de fabrication :
- papier vergé ou peau de vélin poncée pour retenir la poudre colorée,
- fixatifs naturels à base de chair de figue,
- cadres clos pour empêcher la moindre vibration.
Cabinet de curiosités, bustes Renaissance, Jeanne d’Arc et naturalia pour une plongée historique
L’espace le plus pittoresque, installé dans l’ancienne tour de l’Hôtel des Créneaux, reconstitue l’esprit d’un studiolo du XVIIe siècle. On y croise le buste en terre cuite de François Ier attribué à Germain Pilon, la vraie-fausse relique d’un os de narval présenté comme corne de licorne, ou encore un fragment de haubergeon censé avoir appartenu à Jeanne d’Arc, figure incontournable de la ville. Les vitrines mêlent armes, coquillages exotiques, fossiles du bassin de la Loire et miniatures italiennes : un inventaire à la Prévert qui fascine petits et grands.
Des tablettes tactiles livrent les provenances et corrigent les croyances d’époque : le crocodile empaillé, ramené par un officier de la marine orléanaise, passait jadis pour un dragon. Le vendredi à 16 h, un médiateur ouvre quelques tiroirs secrets : monnaie celte découverte à Saran, carnet de voyage du botaniste Desfriches, plume de dodo offerte par le Muséum d’histoire naturelle de Paris. Cette approche vivante du patrimoine fait du musée un relais privilégié pour comprendre la curiosité savante qui irrigua la Renaissance et les Lumières.
Trésors cachés et restaurations d’exception, coulisses de la recherche au musée d’Orléans
Le Portrait d’homme attribué à Vélasquez, histoire d’une restauration emblématique
Resté longtemps catalogué « école espagnole » et rangé dans les réserves, ce visage d’une force saisissante a retrouvé la lumière après un chantier mené en 2021. Dépoussiérage, allègement des vernis brunis, radios X puis réflectographie infrarouge : chaque étape a révélé la touche nerveuse, les repentirs et la palette réduite typiques de Diego Vélasquez. Les spécialistes du Prado, associés au comité scientifique, ont confirmé l’attribution. L’opération a coûté 42 000 €, financés pour moitié par un mécène local et pour moitié par la Ville.
Le public découvre aujourd’hui un tableau vibrant, accroché face aux grands formats français du XVIIe siècle. Un cartel numérique raconte la restauration minute par minute, vidéos à l’appui. Le musée d’Orléans prouve qu’une institution de province peut faire avancer la recherche internationale tout en captant la curiosité des visiteurs, dont 15 % viennent désormais spécialement pour ce Vélasquez fraîchement réhabilité.
Redécouverte de Jean Marie Delaperche, mise en lumière d’un artiste orléanais oublié
En 2018, un inventaire de routine dans les cartons de dessins a mis la main sur près de 120 feuilles signées Jean Marie Delaperche, élève de David et natif d’Orléans. Scènes bibliques, études d’animaux, projets de sculptures : un corpus dense que les bombardements de 1940 avaient fait passer sous les radars. Le service des graphiques a lancé un programme d’étude avec l’université d’Orléans, doublé d’une campagne de dépoussiérage et de montage sous passe-partout neutre.
Une exposition monographique a suivi en 2023, accompagnée d’un catalogue raisonné et d’ateliers de dessin pour le jeune public. Résultat : redonner une identité visuelle au créateur et enrichir l’histoire artistique locale. Les acquisitions récentes de deux bustes en plâtre complètent désormais le parcours permanent, offrant à Delaperche la place qui lui manquait dans le récit du Val de Loire.
Expositions temporaires 2024 2025, agenda culturel au musée des Beaux Arts d’Orléans
Johan Creten Jouer avec le feu, la céramique contemporaine en dialogue avec les maîtres anciens
19 octobre 2024 – 30 mars 2025. Le sculpteur belge, figure majeure du renouveau céramique, investit la nef et les salons rouges avec vingt-cinq pièces monumentales dont La Grande Odalisque et les Plis de la chair. Le parti pris scénographique fait vibrer la terre cuite émaillée face aux Rubens, Jordaens ou Vélasquez du fonds nord-européen. L’artiste a lui-même choisi chaque rapprochement, jouant des reflets et des craquelures pour interroger la représentation du corps, du sacré et du profane.
Dans l’atelier pédagogique, un four raku installée sous verrière permettra au public de suivre des cuissons commentées le premier dimanche du mois. Rencontres avec Johan Creten prévues les 8 novembre et 7 février, réservation en ligne conseillée, jauge 80 places. La visite nocturne du mercredi s’accompagne d’un parcours sonore créé par le Conservatoire d’Orléans, casque inclus dans le billet.
Orléans terre de potiers, archéologie et savoir faire céramique du Val de Loire
6 décembre 2024 – 31 août 2025. Dans la continuité du dialogue contemporain, cette exposition remonte le fil de 2 000 ans de productions locales, des amphores gallo-romaines de Saint-Avertin aux faïences XIXᵉ de Gien. Près de 300 objets exhumés lors des fouilles récentes de la ZAC des Carmes sortent pour la première fois des réserves. Maquettes de fours, outils de tourneurs et panneaux tactiles offrent une lecture technique accessible aux enfants comme aux spécialistes.
Le musée s’ouvre aux artisans d’aujourd’hui : démonstrations de tournage par les potiers de la Borne tout l’hiver, marché de pièces uniques les 14 et 15 décembre dans la cour Langlois. Une carte interactive géolocalise les anciens ateliers le long de la Loire, idéal pour prolonger la découverte à vélo.
Rétrospective Pierre Buraglio, regards croisés sur les grands formats français
11 avril – 21 septembre 2025. Derrière les parois translucides pensées par l’architecte-scénographe Adel Abdessemed, 80 toiles, dessins et « dérestaurations » retracent soixante ans de recherche plastique. Le Musée des Beaux-Arts joue ici sa spécialité du grand format français : les célèbres Olivetti ou Fenêtres de Buraglio dialoguent avec les Troyen et Coypel des collections permanentes, questionnant le motif, la citation et la mémoire.
Les commissaires ont prévu une salle laboratoire où le public compare les états de conservation avant et après restauration, écho direct aux chantiers engagés par le musée ces trois dernières années. Table ronde avec l’artiste, le 16 mai, autour de la question des formats XXL en province, en partenariat avec l’université d’Orléans.
Artistes du terroir et création contemporaine, un musée ancré dans son territoire
Léon Cogniet, Henry de Triqueti et André Bardet, figures locales à (re)découvrir
Le parcours permanent rend justice à trois personnalités ligériennes longtemps éclipsées par les grands maîtres flamands accrochés à l’étage. Premier coup de projecteur sur Léon Cogniet, natif d’Orléans et professeur à l’École des beaux-arts de Paris : ses grandes toiles d’histoire, dont L’Expédition d’Égypte, voisinent avec une sélection de portraits intimes récemment restaurés grâce au mécénat local. Quelques pas plus loin, la galerie de sculptures révèle l’élégance néoclassique de Henry de Triqueti, auteur du décor funéraire du prince Albert à Windsor. Le musée conserve plâtres préparatoires, marbres et carnets de voyage qui éclairent son goût pour les allégories bibliques. La balade s’achève devant les paysages lumineux d’André Bardet (1909-2006), chantre des bords de Loire : coups de brosse gras, ciel changeant, reflets d’eau, tout un patrimoine fluvial peint sur le motif. Réaccrochés par roulement tous les dix-huit mois, ces ensembles rappellent que la création orléanaise ne se laisse pas enfermer dans une période unique.
Programme Hors Cadre, dialogues entre jeunes créateurs et fonds anciens
Lancé en 2022, Hors Cadre invite chaque saison un trio d’artistes de moins de 35 ans à puiser dans les réserves pour ouvrir un face-à-face inattendu. Résultat : des collages monumentaux répondent aux pastels de Quentin de La Tour, des céramiques 3D reprennent les motifs floraux d’une tapisserie Renaissance, un beatmaker transforme le Cabinet de curiosités en installation sonore lors des nocturnes du mercredi. Les interventions, légères et modulables, s’insèrent dans le circuit sans surcharger les salles déjà généreuses en chefs-d’œuvre.
À suivre en 2024-2025 :
- résidence de la photographe Laura Gomy, qui revisitera les batailles de Rubens par un travail de sur-impression numérique
- workshop ouvert aux étudiants de l’université d’Orléans autour des biscuits de Sèvres conservés au musée
- carte blanche à la designer textile Clémentine Baschet, connue pour ses voiles sonores, présentée dans l’atrium à l’automne
En mariant patrimoine et expérimentation, le musée affirme sa vocation de laboratoire artistique régional et renforce l’attractivité d’un centre-ville déjà dynamisé par le flux des visiteurs entre cathédrale, rues commerçantes et quais de Loire.
Médiation culturelle et accessibilité, le musée des familles et des publics spécifiques
Ateliers scolaires, visites sensorielles et Family Week end, une offre inclusive
Du cycle 1 au lycée, le service éducatif multiplie les formats pour faire parler les œuvres : manipulation de pigments devant les pastels de Chardin, initiation au croquis rapide parmi les grands formats flamands, parcours « mythes et légendes » liés à Jeanne d’Arc… Plus de 13 000 élèves sont passés par ces ateliers en 2024, une fréquentation en hausse qui s’explique par la gratuité du transport scolaire offerte par la métropole et une préparation en classe via des dossiers pédagogiques téléchargeables.
Le musée soigne aussi les publics éloignés des codes traditionnels de la visite. Les créneaux « sens 5 » plongent les participants dans la matière : gants tactiles pour apprécier les volumes d’un moulage Renaissance, diffuseurs d’odeurs évoquant l’atelier du potier ou le vernis à l’huile, bande-son enregistrée dans les réserves. Les retours enthousiastes des associations d’aveugles et malvoyants ont poussé l’équipe à doubler les dates en 2025.
Chaque période de vacances accueille enfin le Family Week end. Jeux de piste dans le cabinet de curiosités, atelier argile en écho à « Orléans terre de potiers », lecture contée sous la verrière : pendant deux jours, tous les rendez-vous sont gratuits, sur inscription, avec un objectif assumé : fidéliser les habitants qui reviennent ensuite découvrir les expositions temporaires.

Accessibilité PMR, audioguides LSF et tarif unique à 5 euros, politique d’ouverture
Rampes, ascenseurs et plans inclinés desservent les cinq niveaux, validés par la commission régionale d’accessibilité. Les fauteuils roulants se faufilent sans rupture de parcours même dans les alcôves du fonds de pastels. Pour les visiteurs sourds ou malentendants, l’application maison propose une quarantaine de notices en LSF et en FALC, enrichies par des vidéos réalisées avec l’association Signes de sens.
Le billet unique à 5 € reste l’autre levier d’ouverture. Gratuité pour les moins de 26 ans, premier dimanche du mois et Nuit européenne des musées, réduction groupe dès huit personnes : la politique tarifaire tire la fréquentation sans grever le budget de fonctionnement, le mécénat privé absorbant la différence. Avec un coût moyen de 17 € pour des établissements de même ampleur en région, Orléans confirme son positionnement accueillant et populaire.
Impact touristique et territorial, moteur culturel du centre historique d’Orléans
Parcours musée et cathédrale, synergie patrimoniale qui dynamise le commerce local
Le vis-à-vis entre le Musée des Beaux-Arts et la cathédrale Sainte-Croix crée un circuit piéton compact, deux pôles majeurs séparés par une seule traversée de parvis. Cette proximité génère un flux croisé constant : 68 % des visiteurs déclarent enchaîner les deux sites, selon les enquêtes de sortie 2024. L’effet se mesure dès la sortie des salles d’exposition : librairies indépendantes, boutiques d’artisans et galeries profitent d’un trafic accru, tout comme les marchés de la place du Martroi à l’heure du déjeuner ou du goûter.
Pour les commerçants du centre ancien, chaque exposition événementielle agit comme un coup de projecteur. La rétrospective Johan Creten a fait grimper la fréquentation de 34 % et prolongé la saison touristique d’automne. Les hôteliers observent une hausse des nuitées le week-end, tandis que les guides conférenciers proposent maintenant un forfait « tableaux et vitraux » qui relie Rubens aux chapelles médiévales. Le musée s’affirme ainsi comme un accélérateur économique durable, en particulier grâce à son tarif d’entrée unique à 5 €, attractif pour les familles et les adeptes d’escapades culturelles à la journée.
Partenariats scientifiques avec Tours Blois et l’université d’Orléans, rayonnement régional
Derrière la vitrine touristique se joue un travail de fond, mené avec l’université d’Orléans et les musées de Tours et Blois. Ces trois institutions partagent bases de données, laboratoires de restauration et prêtent en rotation dessins ou céramiques pour nourrir leurs programmations respectives. Le Portrait d’homme attribué à Vélasquez a par exemple été ausculté par le centre de recherche de Tours, avant de rejoindre Blois pour une analyse pigmentaire croisée.
Cette mutualisation attire étudiants en histoire de l’art, conservateurs juniors et chercheurs étrangers qui séjournent, publient, puis reviennent avec leurs propres groupes d’étude. Elle prépare aussi le futur : un projet de réserve externalisée commune, financé par la Région pour 2026, simplifiera la conservation et libérera 300 m² dans les étages orléanais, dédiés à de nouvelles salles de médiation. Un maillage scientifique solide qui consolide le statut du Val de Loire comme destination culturelle de premier plan.
Coulisses de la conservation et transition écoresponsable au musée d’Orléans
Rotation des accrochages, seulement 15 pour cent des œuvres visibles en permanence
Moins d’une pièce sur six reçoit la lumière des galeries. Les réserves abritent 1 700 toiles, des milliers de dessins et l’une des plus vastes collections d’estampes de France, maintenues dans la pénombre pour protéger pigments et papiers. Tout bouge : les pastels, très sensibles, quittent les salles après trois mois, remplacés par des feuilles nordiques ou des grands formats français. Le calendrier d’accrochage, établi deux ans à l’avance, mobilise régisseurs, conservateurs et un monte-charge qui relie les cinq niveaux. Cette stratégie nourrit un programme de micro-expositions incluses dans le billet, donnant régulièrement une scène aux trésors qui dormaient en réserve. Les cartels indiquent désormais le « quota » de lumière accordé à chaque œuvre, un rappel pédagogique de leur fragilité.
Contrôle climatique, éclairage LED et budget de restauration, l’envers du décor durable
Le bâtiment imaginé par Christian Langlois reste calé sur 20 °C et 50 % d’humidité grâce à une gestion technique centralisée pilotée depuis une simple tablette. Les néons ont disparu, remplacés par des LED basse intensité filtrant les UV : douze kilomètres de bandeau lumineux divisent la consommation électrique par deux. Côté restauration, 350 000 € ont été engagés depuis 2022 pour consolider les châssis flamands, dépoussiérer le cabinet de curiosités et raviver le Portrait d’homme attribué à Vélasquez. Les vitrines circulent d’une exposition à l’autre, les cimaises se repeignent au lieu d’être jetées et les transports d’œuvres sont mutualisés avec Blois et Tours. Preuve qu’un patrimoine pluriséculaire peut rayonner tout en réduisant son empreinte carbone.
Du Velasquez ressuscité aux cuissons raku du dimanche, le musée des Beaux Arts d’Orléans montre qu’un établissement provincial peut faire vibrer deux mille ans de création tout en restant accessible à cinq euros. Entre la cathédrale et les quais, chaque visite irrigue le commerce local et alimente un réseau scientifique qui dépasse les frontières du Val de Loire. Quel visage prendra la collection quand la réserve mutualisée ouvrira en 2026 et libérera de nouveaux espaces pour le public ? Les portes sont déjà grandes ouvertes, il ne tient qu’à nous d’ajouter notre pas à cette histoire en mouvement.